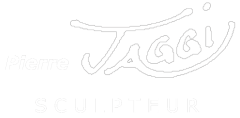Nous nous étions rencontrés pendant la traversée du Sahara, quatre jeunes européens en quête d’aventure et un canadien français, un peu prophète, à grande barbe et petit bonnet. Ensembles, nous avions fêté la nouvelle année 1977 dans le désert, et décidé d’acquérir une pirogue pour descendre le fleuve Niger. Nous l’avons trouvée dans un petit village, en aval de Niamey, et nous nous sommes embarqué sur cet esquif de sept mètres en planches rabotées, assemblées et calfatées. Pour toutes armes, deux perches et trois pagaies, une chambre à air de camion attachée à une corde, (tenant lieu à la fois de baignoire flottante et de canot de sauvetage), équipage, casseroles et moustiquaires. C’est de cette façon que nous avons appareillé. Les perches nous seront bien utiles pour manoeuvrer en eau peu profonde et nous parviendrons, au fil des jours, à manier notre pirogue avec assurance et dextérité. Nous étions partis pour un périple de cinq cent kilomètres, en pays Djerma et Haoussas, les deux principales ethnies qui habitent cette région, loin de tous repères, en dehors du temps… Nous embarquons à l’aube et, rapidement, nous sommes portés par le courant. Les berges semblent lointaines au milieu de ce large fleuve. Une petite brise se lève, les vagues clapotent contre l’embarcation qui paraît fragile vu son équilibre précaire ; le soleil darde déjà puissamment ses rayons. Une pirogue à moteur remonte le courant, débordante de ballots, de marchandises diverses, de paniers de mangues, de graines de palme, de volailles ainsi que des passagers abrités sous de grandes tentures qui faseyent au vent. Peu à peu nous apprivoisons notre embarcation qui se fait plus maniable, et, protégés du soleil par nos turbans, nous adoptons une vitesse de croisière au rythme des pagayes fendant les flots. L’élément liquide se déploie au bout de nos doigts, l’espace nous enveloppe de toutes parts, une douce torpeur s’installe sous le soleil lancinant. La chaleur brouille notre vision et les rives semblent animées de mouvements scintillants. Bientôt nous apercevons des petites pirogues de pêcheurs. Un premier village se profile à l’horizon. La végétation y est particulièrement dense, pour ces contrées de savane sahélienne. D’énormes manguiers et des fromagers gigantesques, dont les fruits fournissent le kapok, ombragent le paysage. Une grande animation règne aux alentours. C’est jour de marché qui a lieu, traditionnellement, tous les cinq jours dans cette partie de l’Afrique. Nous décidons d’accoster le village suivant. La réception qui nous attend sera une véritable surprise. A peine débarqués, les villageois nous entraînent sous l’arbre à palabres où de grandes nattes en paille sont déroulées sur-le-champ ! Nous sommes invités à prendre place pendant que les notables arrivent pour nous saluer, suivis des vieillards et du reste de la population. Avec déférence, les villageois nous offrent en signe de bienvenue la calebasse d’eau réservée aux voyageurs, puis ils apportent de délicieux poissons fumés, embrochés sur des tiges, que l’on retrouve tout le long du fleuve, et de “la boule”, cette bouillie de farine de mil et de lait caillé, très pimentée, parfois sucrée. Ensuite arrivent les arachides bouillies, les mangues et les agrumes, le festin se termine en croquant de la noix de cola.
Nous nous étions rencontrés pendant la traversée du Sahara, quatre jeunes européens en quête d’aventure et un canadien français, un peu prophète, à grande barbe et petit bonnet. Ensembles, nous avions fêté la nouvelle année 1977 dans le désert, et décidé d’acquérir une pirogue pour descendre le fleuve Niger. Nous l’avons trouvée dans un petit village, en aval de Niamey, et nous nous sommes embarqué sur cet esquif de sept mètres en planches rabotées, assemblées et calfatées. Pour toutes armes, deux perches et trois pagaies, une chambre à air de camion attachée à une corde, (tenant lieu à la fois de baignoire flottante et de canot de sauvetage), équipage, casseroles et moustiquaires. C’est de cette façon que nous avons appareillé. Les perches nous seront bien utiles pour manoeuvrer en eau peu profonde et nous parviendrons, au fil des jours, à manier notre pirogue avec assurance et dextérité. Nous étions partis pour un périple de cinq cent kilomètres, en pays Djerma et Haoussas, les deux principales ethnies qui habitent cette région, loin de tous repères, en dehors du temps… Nous embarquons à l’aube et, rapidement, nous sommes portés par le courant. Les berges semblent lointaines au milieu de ce large fleuve. Une petite brise se lève, les vagues clapotent contre l’embarcation qui paraît fragile vu son équilibre précaire ; le soleil darde déjà puissamment ses rayons. Une pirogue à moteur remonte le courant, débordante de ballots, de marchandises diverses, de paniers de mangues, de graines de palme, de volailles ainsi que des passagers abrités sous de grandes tentures qui faseyent au vent. Peu à peu nous apprivoisons notre embarcation qui se fait plus maniable, et, protégés du soleil par nos turbans, nous adoptons une vitesse de croisière au rythme des pagayes fendant les flots. L’élément liquide se déploie au bout de nos doigts, l’espace nous enveloppe de toutes parts, une douce torpeur s’installe sous le soleil lancinant. La chaleur brouille notre vision et les rives semblent animées de mouvements scintillants. Bientôt nous apercevons des petites pirogues de pêcheurs. Un premier village se profile à l’horizon. La végétation y est particulièrement dense, pour ces contrées de savane sahélienne. D’énormes manguiers et des fromagers gigantesques, dont les fruits fournissent le kapok, ombragent le paysage. Une grande animation règne aux alentours. C’est jour de marché qui a lieu, traditionnellement, tous les cinq jours dans cette partie de l’Afrique. Nous décidons d’accoster le village suivant. La réception qui nous attend sera une véritable surprise. A peine débarqués, les villageois nous entraînent sous l’arbre à palabres où de grandes nattes en paille sont déroulées sur-le-champ ! Nous sommes invités à prendre place pendant que les notables arrivent pour nous saluer, suivis des vieillards et du reste de la population. Avec déférence, les villageois nous offrent en signe de bienvenue la calebasse d’eau réservée aux voyageurs, puis ils apportent de délicieux poissons fumés, embrochés sur des tiges, que l’on retrouve tout le long du fleuve, et de “la boule”, cette bouillie de farine de mil et de lait caillé, très pimentée, parfois sucrée. Ensuite arrivent les arachides bouillies, les mangues et les agrumes, le festin se termine en croquant de la noix de cola.  Nos bagages sont débarqués de la pirogue, une grande case est mise à notre disposition pour y passer la nuit, nous sommes le centre d’attraction… impossible de repartir le même jour. Nous nous sentons comme tombés du ciel face à cet accueil fantastique et nous sommes un peu gênés de toute cette attention. Les femmes ont coutume de se prosterner devant les étrangers en signe de respect. Désorientés par cet acte démesurément servile à nos yeux, nous aurons beaucoup de peine à les dissuader d’agir ainsi envers nous. A chaque halte, cette scène d’accueil se renouvellera. Parfois nous parviendrons, après moult salamalecs et poignées de mains, à continuer notre périple sans devoir obligatoirement passer la nuit dans le village abordé. Souvent, nous trouverons à notre départ, en guise de cadeau, au fond de la pirogue, quelque volaille vivante, pattes entravées, et quantité de poissons fumés. Dans de nombreux villages ne possédant pas d’autres accès que le fleuve, les enfants, les femmes et de nombreux hommes n’ont jamais vu de “blancs”, et il arrivera que la réception tourne à l’émeute, chacun gesticulant et parlant à la fois en se bousculant pour nous voir et nous toucher. Le brouhaha s’étant apaisé, les enfants continuent de nous approcher pour essayer de passer leurs mains dans nos cheveux et rivaliser d’audace entre eux, tenus à distance par les notables avec lesquels nous tentons de converser. Rapidement, nous apprenons quelques mots de la langue vernaculaire.
Nos bagages sont débarqués de la pirogue, une grande case est mise à notre disposition pour y passer la nuit, nous sommes le centre d’attraction… impossible de repartir le même jour. Nous nous sentons comme tombés du ciel face à cet accueil fantastique et nous sommes un peu gênés de toute cette attention. Les femmes ont coutume de se prosterner devant les étrangers en signe de respect. Désorientés par cet acte démesurément servile à nos yeux, nous aurons beaucoup de peine à les dissuader d’agir ainsi envers nous. A chaque halte, cette scène d’accueil se renouvellera. Parfois nous parviendrons, après moult salamalecs et poignées de mains, à continuer notre périple sans devoir obligatoirement passer la nuit dans le village abordé. Souvent, nous trouverons à notre départ, en guise de cadeau, au fond de la pirogue, quelque volaille vivante, pattes entravées, et quantité de poissons fumés. Dans de nombreux villages ne possédant pas d’autres accès que le fleuve, les enfants, les femmes et de nombreux hommes n’ont jamais vu de “blancs”, et il arrivera que la réception tourne à l’émeute, chacun gesticulant et parlant à la fois en se bousculant pour nous voir et nous toucher. Le brouhaha s’étant apaisé, les enfants continuent de nous approcher pour essayer de passer leurs mains dans nos cheveux et rivaliser d’audace entre eux, tenus à distance par les notables avec lesquels nous tentons de converser. Rapidement, nous apprenons quelques mots de la langue vernaculaire.  Parfois un maître d’école, si le bourg a une certaine notoriété, un émigré de retour au village ou un érudit ayant voyagé, parle le français, et les échanges verbaux gagnent en importance. De cette manière, nous avons enchaîné les milles parcourus sur le fleuve, côtoyant les rives ou nous laissant mener par le courant. Nous avons contemplé les larges étendues sauvages parsemées de vénérables baobabs et d’arbustes chétifs, observés le ballet des oiseaux pêcheurs, longés les hautes falaises du parc national du W, croisés à plusieurs reprises les hippopotames, seuls ou en groupe, que nous entendions folâtrer avant de les apercevoir. Par une nuit idyllique de pleine lune, nous avons tenté de naviguer, mais avons dû rapidement renoncer à notre entreprise, à cause des moustiques qui nous ont littéralement dévorés. C’est en catastrophe que nous avons regagné la rive pour y dresser un campement de fortune, pénétrant du même coup la vigoureuse bulle sonore des coassements tenaces et obstinés des crapauds, et avec bonheur, nous nous sommes engouffrés sous nos moustiquaires. Les berges, rectilignes ou sinueuses, pelées ou arborées, hébergent une pléthore d’insectes, une grande variété de reptiles. Les palmipèdes et les échassiers y foisonnent. Des rongeurs de tous poils, de nombreuses espèces d’animaux, petits ou gros, rampent, volent, nagent, grimpent, sautent, voltigent ou papillonnent et s’accompagnent de leurs différents cris, chants, bruissements, gazouillis, sifflements, stridulations ou frémissements. Faune et flore s’accordent et s’équilibrent. Cet état de fait devient cependant de plus en plus précaire, les menaces déstabilisatrices s’appellent démographie, pollution, désertification …
Parfois un maître d’école, si le bourg a une certaine notoriété, un émigré de retour au village ou un érudit ayant voyagé, parle le français, et les échanges verbaux gagnent en importance. De cette manière, nous avons enchaîné les milles parcourus sur le fleuve, côtoyant les rives ou nous laissant mener par le courant. Nous avons contemplé les larges étendues sauvages parsemées de vénérables baobabs et d’arbustes chétifs, observés le ballet des oiseaux pêcheurs, longés les hautes falaises du parc national du W, croisés à plusieurs reprises les hippopotames, seuls ou en groupe, que nous entendions folâtrer avant de les apercevoir. Par une nuit idyllique de pleine lune, nous avons tenté de naviguer, mais avons dû rapidement renoncer à notre entreprise, à cause des moustiques qui nous ont littéralement dévorés. C’est en catastrophe que nous avons regagné la rive pour y dresser un campement de fortune, pénétrant du même coup la vigoureuse bulle sonore des coassements tenaces et obstinés des crapauds, et avec bonheur, nous nous sommes engouffrés sous nos moustiquaires. Les berges, rectilignes ou sinueuses, pelées ou arborées, hébergent une pléthore d’insectes, une grande variété de reptiles. Les palmipèdes et les échassiers y foisonnent. Des rongeurs de tous poils, de nombreuses espèces d’animaux, petits ou gros, rampent, volent, nagent, grimpent, sautent, voltigent ou papillonnent et s’accompagnent de leurs différents cris, chants, bruissements, gazouillis, sifflements, stridulations ou frémissements. Faune et flore s’accordent et s’équilibrent. Cet état de fait devient cependant de plus en plus précaire, les menaces déstabilisatrices s’appellent démographie, pollution, désertification …  Les lavandières assises au bord du fleuve, jambes allongées, un morceau de pagne décoloré autour de la taille et un bébé accroché à un sein, lavent leur linge avec des pains de savon qu’elles préparent à partir d’un fruit saponacé mélangé à de la potasse. Une ribambelle d’enfants batifole autour d’elles. Tout comme les autres villageoises d’Afrique où le moulin à gasoil n’est pas encore arrivé, les femmes pillent le mil, le sorgho ou le fogno pour faire de la farine. En cadence, à plusieurs autour du même mortier, elles frappent tour à tour les graines, et rythment leur allure avec leurs chants et en tapant dans leurs mains à chaque rebond de leur grand pilon en bois. La houe sur l’épaule, elles se rendent aussi au champ, en reviennent avec des brassées de bois pour la cuisine, sont de corvée d’eau, s’occupent des enfants et de la nourriture, des animaux domestiques, de l’irrigation des jardins, balayent la cour des concessions, réfectionnent les murs des cases et font les sols en terre battue. Traditionnellement, elles sont aussi potières quand leur mari est forgeron. Le petit commerce et l’approvisionnement les mènent parfois à marcher plusieurs dizaines de kilomètres sur des sentiers de brousse, l’une derrière l’autre, pour aller jusqu’au marché avec un lourd chargement en équilibre sur leur tête. Les jours de fête, elles portent parures et bijoux en sus de leurs gris-gris ; tongs et pagnes rutilants sont aussi de mise. Quand elles en ont le temps, elles se nattent mutuellement les cheveux ; la coiffure à la mode chez les jeunes filles s’appelle “toutofil”, elle se fait avec du fil en plastique noir et brillant entortillé autour de chaque mèche, le résultat est bon quand la tête est hérissée d’antennes ! Souvent, nous entendrons au loin, porté par le fleuve, le son des tam-tams et des balafons, célébrant sans doute quelque cérémonie, tel que baptême, mariage ou funérailles. Le pêcheur à l’épervier, de sa petite pirogue taillée dans un tronc évidé, lance à la volée son filet conique dans une eau peu profonde. Ses gestes sont aussi immuables que ses mouvements sont gracieux. D’ordinaire, il n’attrape que du menu fretin, les prises plus importantes se font avec des nasses tissées ou des filets flottants. Ces villages de cultivateurs-pêcheurs-chasseurs-cueilleurs disséminés le long du fleuve, paraissent flotter hors du temps. L’atmosphère qui en émane est teintée de quiétude, d’équilibre et d’harmonie et incite à se remémorer les paroles du poète : “Ici tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté”. Pour ses habitants, le fleuve est source de vie, mémoire, puissance, résidence des génies et des esprits, c’est aussi la voie d’accès et de communication. La plupart de ces gens vivent en autarcie. De superbes poteries et d’innombrables calebasses servent à l’usage domestique. Ces objets traditionnels côtoient les récipients en émail, qui font partie des quelques biens de consommation dont ces gens disposent, tout comme le pétrole des lampes, ingénieusement élaborées à partir de boîtes de conserves, les sucreries, bonbons, allumettes, cigarettes vendues à la pièce par le tablier du coin, petit marchand ambulant et son étal transportable. Il propose parfois aussi quelques médicaments ou un lot d’articles chinois trônant à côté des incontournables noix de cola. Présente à toutes les cérémonies, culturellement très importante, la noix de cola, véritable monnaie symbolique, accompagne les moments clés de la vie sociale, scelle les échanges, les transactions et les offrandes. Les “yougou-yougou”, littéralement “secoué-secoué”, sont le nom donné aux fripes, que l’on retrouve jusque sur les marchés les plus reculés. C’est ce que fait subir, l’éventuel client, au vêtement qu’il désire acquérir pour le débarrasser de sa poussière. Costumes et pagnes traditionnels sont encore largement usités. Dans chaque village on rencontre des tisserands qui, sur leurs petits métiers, fabriquent de longues bandes de tissu de plusieurs mètres. Assemblées, elles deviendront pagnes, couvertures ou serviront à la confection de l’habillement.
Les lavandières assises au bord du fleuve, jambes allongées, un morceau de pagne décoloré autour de la taille et un bébé accroché à un sein, lavent leur linge avec des pains de savon qu’elles préparent à partir d’un fruit saponacé mélangé à de la potasse. Une ribambelle d’enfants batifole autour d’elles. Tout comme les autres villageoises d’Afrique où le moulin à gasoil n’est pas encore arrivé, les femmes pillent le mil, le sorgho ou le fogno pour faire de la farine. En cadence, à plusieurs autour du même mortier, elles frappent tour à tour les graines, et rythment leur allure avec leurs chants et en tapant dans leurs mains à chaque rebond de leur grand pilon en bois. La houe sur l’épaule, elles se rendent aussi au champ, en reviennent avec des brassées de bois pour la cuisine, sont de corvée d’eau, s’occupent des enfants et de la nourriture, des animaux domestiques, de l’irrigation des jardins, balayent la cour des concessions, réfectionnent les murs des cases et font les sols en terre battue. Traditionnellement, elles sont aussi potières quand leur mari est forgeron. Le petit commerce et l’approvisionnement les mènent parfois à marcher plusieurs dizaines de kilomètres sur des sentiers de brousse, l’une derrière l’autre, pour aller jusqu’au marché avec un lourd chargement en équilibre sur leur tête. Les jours de fête, elles portent parures et bijoux en sus de leurs gris-gris ; tongs et pagnes rutilants sont aussi de mise. Quand elles en ont le temps, elles se nattent mutuellement les cheveux ; la coiffure à la mode chez les jeunes filles s’appelle “toutofil”, elle se fait avec du fil en plastique noir et brillant entortillé autour de chaque mèche, le résultat est bon quand la tête est hérissée d’antennes ! Souvent, nous entendrons au loin, porté par le fleuve, le son des tam-tams et des balafons, célébrant sans doute quelque cérémonie, tel que baptême, mariage ou funérailles. Le pêcheur à l’épervier, de sa petite pirogue taillée dans un tronc évidé, lance à la volée son filet conique dans une eau peu profonde. Ses gestes sont aussi immuables que ses mouvements sont gracieux. D’ordinaire, il n’attrape que du menu fretin, les prises plus importantes se font avec des nasses tissées ou des filets flottants. Ces villages de cultivateurs-pêcheurs-chasseurs-cueilleurs disséminés le long du fleuve, paraissent flotter hors du temps. L’atmosphère qui en émane est teintée de quiétude, d’équilibre et d’harmonie et incite à se remémorer les paroles du poète : “Ici tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté”. Pour ses habitants, le fleuve est source de vie, mémoire, puissance, résidence des génies et des esprits, c’est aussi la voie d’accès et de communication. La plupart de ces gens vivent en autarcie. De superbes poteries et d’innombrables calebasses servent à l’usage domestique. Ces objets traditionnels côtoient les récipients en émail, qui font partie des quelques biens de consommation dont ces gens disposent, tout comme le pétrole des lampes, ingénieusement élaborées à partir de boîtes de conserves, les sucreries, bonbons, allumettes, cigarettes vendues à la pièce par le tablier du coin, petit marchand ambulant et son étal transportable. Il propose parfois aussi quelques médicaments ou un lot d’articles chinois trônant à côté des incontournables noix de cola. Présente à toutes les cérémonies, culturellement très importante, la noix de cola, véritable monnaie symbolique, accompagne les moments clés de la vie sociale, scelle les échanges, les transactions et les offrandes. Les “yougou-yougou”, littéralement “secoué-secoué”, sont le nom donné aux fripes, que l’on retrouve jusque sur les marchés les plus reculés. C’est ce que fait subir, l’éventuel client, au vêtement qu’il désire acquérir pour le débarrasser de sa poussière. Costumes et pagnes traditionnels sont encore largement usités. Dans chaque village on rencontre des tisserands qui, sur leurs petits métiers, fabriquent de longues bandes de tissu de plusieurs mètres. Assemblées, elles deviendront pagnes, couvertures ou serviront à la confection de l’habillement. Parfois, un jeune homme nouvellement revenu d’ailleurs, arbore fièrement des lunettes de soleil, une montre bracelet, une paire de baskets ou un poste de radio tout neuf. C’est la grande classe, l’effet est garanti auprès de ceux de sa génération, “En tous cas, c’est trop fort quoi…vraiment ! “. Il arrive qu’une unique famille élise domicile dans un des méandres du fleuve, un pêcheur, ses épouses et leurs enfants. Une ou deux cases, un fumoir et différents ustensiles de cuisine balisent les lieux, où s’égaient aussi quelques poules et pintades, voire une grue couronnée domestiquée, parfois même une chèvre, une vache ou un chien. A la fin du jour, certains arbres se recouvrent de grandes roussettes qui viennent se nicher tête en bas, drapées dans leurs ailes. C’est le moment ou les chasseurs en herbe délaissent les margouillats pour ces nouvelles proies. En sauce, elles diversifient le repas quotidien. Les termites grillés sont bien appréciés comme friandises ; le vin de palme et la bière de mil accompagnent les moments de détente. Avant l’aube, les activités reprennent ; l’heure est aux ablutions, à la prière, au début des tâches domestiques. Dès les premières lueurs, les perroquets entonnent leur caquetage en chœur, le marabout prend son essor, l’oiseau pêcheur entame son lent ballet sur le fleuve. Une nouvelle journée commence entre saison sèche et saison des pluies. L’immuable quotidien d’un présent chaque jour renouvelé, est, par nature, stabilisateur et rassurant pour ces populations. L’appartenance au groupe, le respect des règles coutumières et des traditions ainsi que la subordination aux décisions des anciens laissent peu de place au questionnement individuel, au changement personnel ; mais c’est aussi un puissant médicament contre le mal-être, un ciment réunificateur et identificateur qui lie chacun à ces racines communes et où tous trouvent leur place sur l’échiquier de cette vie grégaire. Au plus proche de la nature, en harmonie avec leur milieu, en osmose avec leur environnement, ces habitants n’imaginent pas quelle exception ils représentent. Les villages s’égrainent comme des perles sur un chapelet, toujours pareils et chaque fois différents, parfois distants de plusieurs heures de navigation l’un de l’autre. Nous ferons des rencontres intenses, étonnantes, chaleureuses, et vivrons des moments émouvants, remarquables, fantastiques, en dehors de nos repères, en dehors de notre temps. Nous passerons en territoire nigérian sans y prêter garde, et c’est à notre arrivée à Yelva-yaouri, première petite ville rencontrée depuis notre départ que nous apprendrons des autorités locales que le poste frontière se trouve à deux cents kilomètres en amont, environ ! Le douanier de service nous logera dans sa chambre, le temps qu’il réquisitionne les places nécessaires sur une grosse pirogue à moteur, pour que nous puissions retourner sur notre sillage et faire tamponner nos passeports. Un aller-retour, juchés sur des baluchons, avec en trame de fonds, le ronronnement lancinant du moteur. Nous céderons ensuite notre embarcation pour continuer ce périple sur les routes du pays le plus peuplé d’Afrique, jusqu’à la capitale Lagos. J’y fêterai mes vingt ans et trouverai un autre embarquement, sur un cargo battant pavillon panaméen. A son bord, un capitaine grec, un second chypriote et un équipage cosmopolite. Je passerai quinze jours avec eux. Pour payer mon passage, j’éplucherai des patates et aiderai à nettoyer une cale grande comme une cathédrale, qui recevra les phosphates que le navire va chercher au Togo. C’est là que je débarquerai un jour de grande houle, sur un petit canot qui me déposera à terre, et je poursuivrai mon voyage à travers cette Afrique de toutes les couleurs et de toutes les senteurs : mais ceci est une autre histoire…
Parfois, un jeune homme nouvellement revenu d’ailleurs, arbore fièrement des lunettes de soleil, une montre bracelet, une paire de baskets ou un poste de radio tout neuf. C’est la grande classe, l’effet est garanti auprès de ceux de sa génération, “En tous cas, c’est trop fort quoi…vraiment ! “. Il arrive qu’une unique famille élise domicile dans un des méandres du fleuve, un pêcheur, ses épouses et leurs enfants. Une ou deux cases, un fumoir et différents ustensiles de cuisine balisent les lieux, où s’égaient aussi quelques poules et pintades, voire une grue couronnée domestiquée, parfois même une chèvre, une vache ou un chien. A la fin du jour, certains arbres se recouvrent de grandes roussettes qui viennent se nicher tête en bas, drapées dans leurs ailes. C’est le moment ou les chasseurs en herbe délaissent les margouillats pour ces nouvelles proies. En sauce, elles diversifient le repas quotidien. Les termites grillés sont bien appréciés comme friandises ; le vin de palme et la bière de mil accompagnent les moments de détente. Avant l’aube, les activités reprennent ; l’heure est aux ablutions, à la prière, au début des tâches domestiques. Dès les premières lueurs, les perroquets entonnent leur caquetage en chœur, le marabout prend son essor, l’oiseau pêcheur entame son lent ballet sur le fleuve. Une nouvelle journée commence entre saison sèche et saison des pluies. L’immuable quotidien d’un présent chaque jour renouvelé, est, par nature, stabilisateur et rassurant pour ces populations. L’appartenance au groupe, le respect des règles coutumières et des traditions ainsi que la subordination aux décisions des anciens laissent peu de place au questionnement individuel, au changement personnel ; mais c’est aussi un puissant médicament contre le mal-être, un ciment réunificateur et identificateur qui lie chacun à ces racines communes et où tous trouvent leur place sur l’échiquier de cette vie grégaire. Au plus proche de la nature, en harmonie avec leur milieu, en osmose avec leur environnement, ces habitants n’imaginent pas quelle exception ils représentent. Les villages s’égrainent comme des perles sur un chapelet, toujours pareils et chaque fois différents, parfois distants de plusieurs heures de navigation l’un de l’autre. Nous ferons des rencontres intenses, étonnantes, chaleureuses, et vivrons des moments émouvants, remarquables, fantastiques, en dehors de nos repères, en dehors de notre temps. Nous passerons en territoire nigérian sans y prêter garde, et c’est à notre arrivée à Yelva-yaouri, première petite ville rencontrée depuis notre départ que nous apprendrons des autorités locales que le poste frontière se trouve à deux cents kilomètres en amont, environ ! Le douanier de service nous logera dans sa chambre, le temps qu’il réquisitionne les places nécessaires sur une grosse pirogue à moteur, pour que nous puissions retourner sur notre sillage et faire tamponner nos passeports. Un aller-retour, juchés sur des baluchons, avec en trame de fonds, le ronronnement lancinant du moteur. Nous céderons ensuite notre embarcation pour continuer ce périple sur les routes du pays le plus peuplé d’Afrique, jusqu’à la capitale Lagos. J’y fêterai mes vingt ans et trouverai un autre embarquement, sur un cargo battant pavillon panaméen. A son bord, un capitaine grec, un second chypriote et un équipage cosmopolite. Je passerai quinze jours avec eux. Pour payer mon passage, j’éplucherai des patates et aiderai à nettoyer une cale grande comme une cathédrale, qui recevra les phosphates que le navire va chercher au Togo. C’est là que je débarquerai un jour de grande houle, sur un petit canot qui me déposera à terre, et je poursuivrai mon voyage à travers cette Afrique de toutes les couleurs et de toutes les senteurs : mais ceci est une autre histoire…
Pierre Jaggi septembre 2001